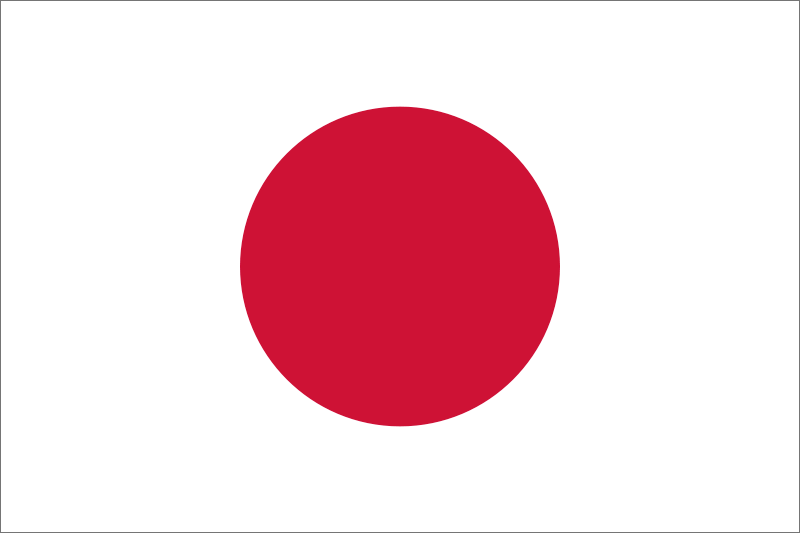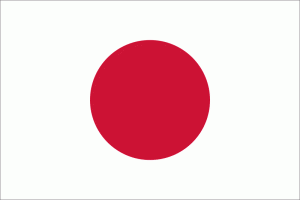À la dérive depuis plusieurs années, le jeu vidéo japonais essaie de se réinventer en s’appuyant sur l’efficacité technologique de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Comment le Japon, bien aimée force vive du jeu vidéo mondial ressuscité au milieu des années 80 grâce à la première console Nintendo en est-il arrivé là ?
« Je crois que le marché du jeu vidéo japonais finira bientôt comme l’industrie du film japonais« , dénonçait le développeur star de la Team Ninja, Tomonobu Itagaki, en 2009. « Ce que fait actuellement l’industrie japonaise du jeu vidéo est une forme moderne de sakoku (politique isolationniste du Japon du XVIIe siècle, NDR). » Voilà plusieurs années déjà que le déclin de la puissance fédératrice du jeu vidéo japonais est amorcée. Aujourd’hui, le jeu made in Japan représente moins de 10 % quand il pesait encore 50 % du marché mondial en 2002 ! Les causes sont multiples : débarquement massif de l’américain Microsoft dans le marché du jeu sur consoles qui a imposé à coup de budgets marketing et de développement le règne du blockbuster (Lire à ce sujet : Call of Duty Modern Warfare 2, 550 M$ de recettes : le triomphe à retardement de l’ère Bush) ; petit pas de côté d’un Nintendo affaibli au début des années 2000 qui a encouragé des productions économiques plus vite rentables sur DS et Wii ; conservatisme chronique des développeurs de jeu vidéo japonais au service d’un public insulaire imperméables aux productions venues d’ailleurs.
Ni Xbox 360, ni PlayStation 3
En 2007, l’atypique producteur Atsushi Inaba (Steel Battalion, Viewtifull Joe, Okami…) commençait à exprimer le malaise, tiraillé entre deux consoles nouvelles générations surpuissantes : « Travailler pour la Xbox 360 peut conduire à un succès aux USA mais pas au Japon où la console ne se vend pas » regrettait-il, « Le pouvoir de la marque PlayStation est bien en place au Japon mais la PS3 n’est pas répandue ailleurs« . Devant le foudroyant God of War américain au « goût de jeu japonais sans l’être », Inaba stigmatisait déjà un savoir-faire en perdition : « Vous ne voyez pas beaucoup de jeux japonais avoir du succès à l’étranger. » À la même époque le producteur et compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka, avouait son admiration pour les développeurs américains développant sous sa supervision l’épisode 5 du survival horror : « Leurs aptitudes graphiques et technologiques sont incroyables » disait-il alors. Handicap bêtement trivial : les puissants moteurs graphiques américains de plus en plus répandus dans les grosses productions 3D (Quake, Unreal…) étaient difficilement accessibles aux développeurs japonais parce que non traduits en japonais ! « Pendant qu’on attend la traduction, nous prenons une étape de retard par rapport à ceux qui comprennent l’anglais« . Fin 2009, Keiji Inafune, la star de Mega Man et Onimusha, enfonce le clou au Tokyo Game Show : « Le Japon est fini. Nous sommes fichus. Notre industrie est finie« . « Le Japon a au moins 5 ans de retard sur l’ouest » diagnostique ainsi le responsable de la recherche et du développement de Capcom.
Citoyen-Japonais du monde
Pour réussir dans le jeu vidéo aujourd’hui « il faut être un terrien d’abord et un japonais ensuite » affirme Tomonobu Itagaki. Même si les effets ne se font pas encore sentir, l’industrie japonaise a commencé à réagir. De façon spectaculaire avec l’acquisition en 2009 de l’éditeur britannique Eidos (Tomb Raider, le prochain Deus Ex…) par le méga éditeur Square-Enix jusque là grand spécialiste des jeux de rôles japonais (Final Fantasy, Dragon Quest). Et plus discrètement avec des éditeurs nippons envisageant sérieusement l’achat d’équipes occidentales ayant fait leurs preuves. Capcom vient ainsi de devenir majoritaire dans le studio canadien Blue Castle développeur de la suite de Dead Rising qui a réussi l’exploit de se vendre à 2 millions d’exemplaires en un mois. Échaudé par l’échec technique et commercial de Dark Void, une création, et de Bionic Commando, une re-création contemporaine, délégués à des studios respectivement américains et suédois, le même Capcom annonce en mai dernier qu’il ne confiera désormais que des suites de franchises bien établies à des studios occidentaux. Réincarné dans un héros aux cheveux noirs d’encre qui a choqué les puristes de la série, le prochain Devil May Cry est en cours de réalisation au sein du talentueux studio anglais Ninja Theory (Enslaved : Oddyssey to the West). Une méthode de collaboration est-ouest que Nintendo, là aussi précurseur, avait déjà tenté et réussi dans les années 90 et 2000 avec les anglais de Rare (GoldenEye 007, Donkey Kong…) et les texans de Retro Studios sur la série Metroid Prime et le prochain Donkey Kong Country Returns sur Wii. Aujourd’hui sur les étalages, à côté du transfuge Dead Rising 2, le nouveau Castlevania : Lords of Shadow de Konami a été réalisé par les espagnols de Mercury Steam sous la supervision de la star japonaise Hideo Kojima (Metal Gear Solid).
Néo cross-over
La mutation s’avère plus douloureuse du côté des développeurs japonais ambitieux encore indépendants. Malgré de gros efforts d’occidentalisation de leurs nouvelles créations. Les très américanisés Mad World de PlatinumGames et No More Heroes de Grasshopper ont fait un four sur Wii. Et il faudra guetter l’accueil mondial de l’étonnant, mais bâtard, Vanquish qui greffe, jusqu’à frôler la parodie high-tech, le modèle Gears of War à des affrontements mécha japonais. Son auteur, justement, l’insaisissable Shinji Mikami, a accepté de rejoindre l’éditeur américain Zenimax/Bethesda en compagnie de son studio attitré tokyoïte Tango Gameworks. L’auteur de Resident Evil côtoie ainsi les créateurs de Doom et Quake. Une situation inédite qui annonce peut-être une migration opportuniste vers l’ouest de quelques pointures japonaises courant après un vrai succès international. La crise identitaire du jeu vidéo à la japonaise s’apprête ainsi à donner naissance à un nouveau melting-pot économique et culturel américano-japonais sans que l’on sache très bien à qui il va profiter.
François Bliss de la Boissière
(Publié en avril 2011 dans Chronic’art)