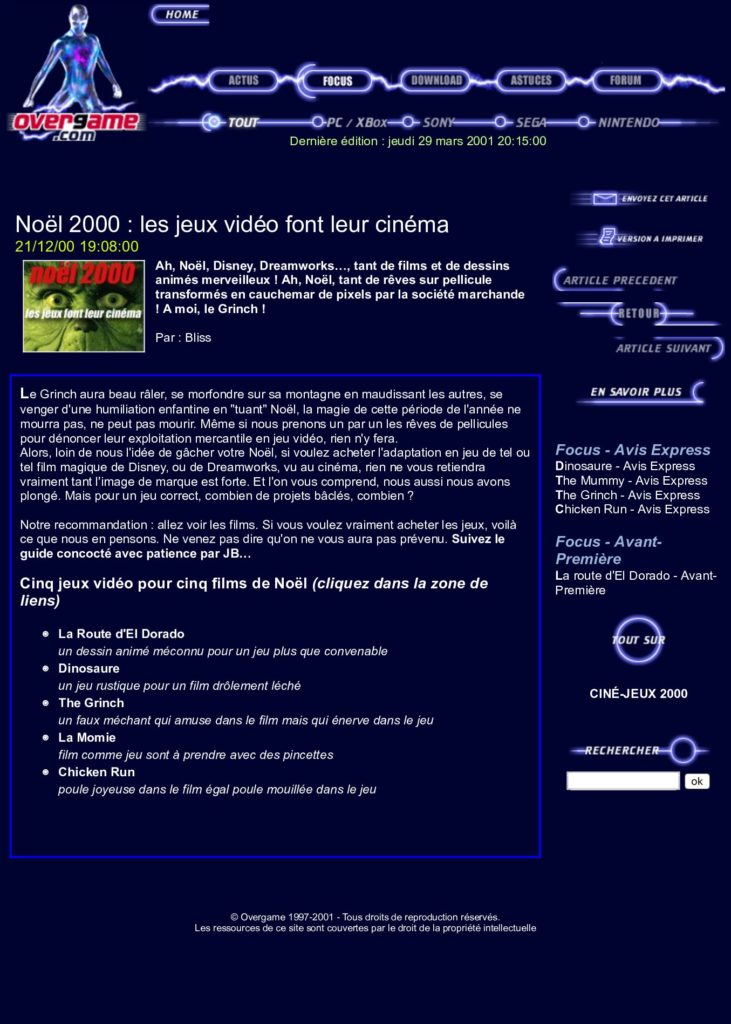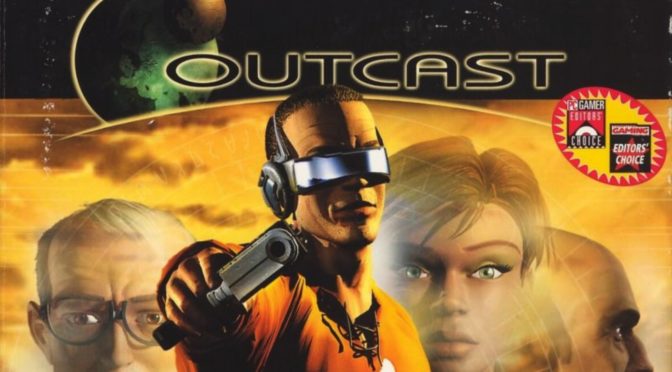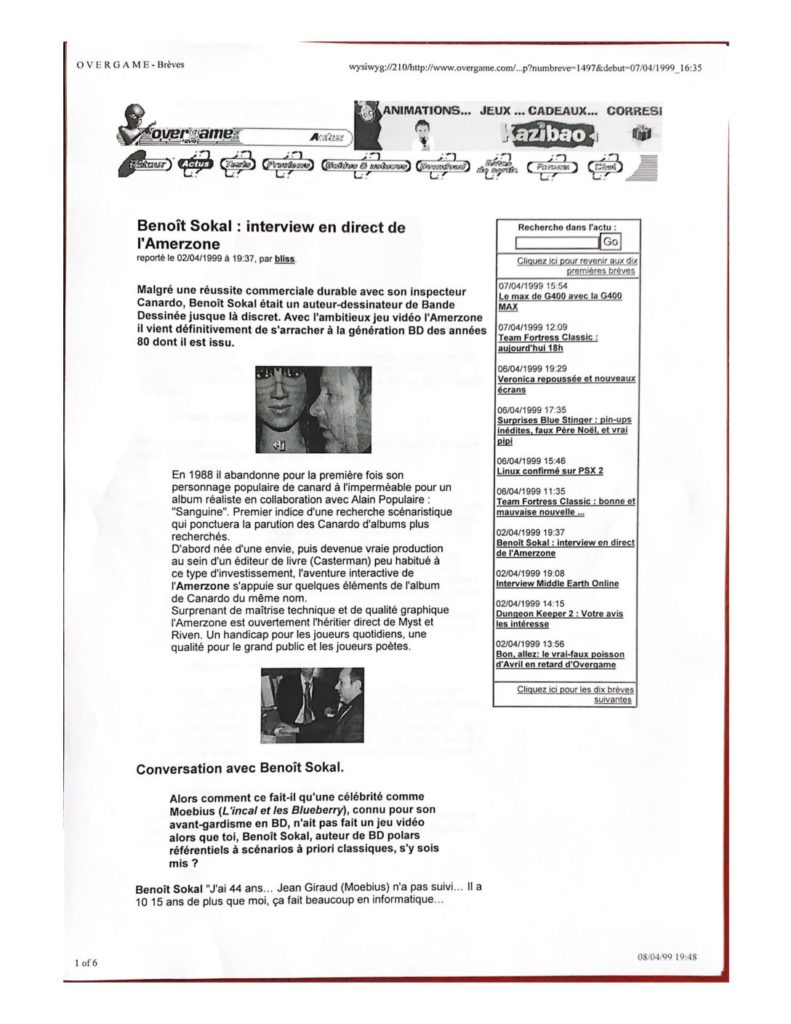Préambule relecture 2011…
L’introduction ci-dessous le disait alors, au-delà de la tristesse provoquée par le cataclysme tombé sur New York en septembre, l’année jeux vidéo 2001 avait été particulièrement fructueuse. Ico arrivait en sourdine au milieu d’un jeu vidéo bien occupé à autre chose qu’à traverser en silence une forteresse désertée et presque monochrome. Convaincre alors par le texte et la critique qu’il se passait là quelque chose d’inhabituel et même de capital n’a pas été chose aisée. Il fallut prendre sur soi et ses propres congés pour jouer le jeu jusqu’au bout. Les discussions allaient bon train dans la rédaction à cette époque et il a aussi fallu passer en force cet énorme compliment parmi une population de gamers, majoritaire ici ou ailleurs, guère réceptive à toutes les nuances, sans doute féminines, de Ico. Le 9,5 sur 10 alors imposé contre tous a sonné comme une hérésie, et même une trahison. Aujourd’hui, alors qu’Ico et sa suite Shadow of the Colossus appartiennent au patrimoine du jeu vidéo mais aussi de l’humanité et que la double réédition en HD et 3D rend à nouveau accessible les deux chef d’œuvres de Fumito Ueda, le rédacteur savoure aujourd’hui doucement, et sans plus de fierté qu’il n’en faut, le bien fondé de la petite lutte intellectuelle qu’il a alors mené dix ans plus tôt pour essayer de projeter le jeu dans la lumière qu’il méritait. En attendant, le temps qu’il faudra, The Last Guardian qui reviendra éclairer un jeu vidéo de plus en plus égaré, pour ne pas dire hagard.
Voilà ce que ce rédacteur énamouré disait alors d’un Ico qui vaut encore toutes les louanges aujourd’hui dans sa version 3D qui recrée un nouveau vertige des sens.
ICO : la Playstation 2 a trouvé son âme
Passionnant, poétique, profond, léger, inattendu, singulier, fascinant, harmonieux, délicat, subtil et surtout hyper jouable, l’Emotion Engine de la Playstation 2 porte enfin bien son nom. En un mot : chef-d’œuvre.
Préambule obligatoire : Bons jeux, la rançon du succès
Quelle année 2001 pour les jeux vidéo ! Mais c’est une chose d’anticiper la tempête, et une autre d’être dedans. Jouer d’une traite à Final Fantasy X, Gran Turismo 3, Devil May Cry, Max Payne, Silent Hill 2, Super Monkey Ball, Wave Race Blue Storm, Commandos 2, WRC, Luigi’s Mansion, a de quoi donner le vertige. Même à un professionnel qui en a vu d’autres. Tous des jeux uniques, formidables, totalement différents les uns des autres, incontournables pour les consommateurs et la culture jeu vidéo. Un concentré vidéo ludique qui excuse toutes les erreurs passées de l’industrie, les attentes vaines, les promesses non tenues. Que dire ensuite pour attirer l’attention sur un jeu qui, lui non plus, ne ressemble pas aux autres ? Un jeu qui réussit l’exploit de scotcher à l’écran un joueur qui, depuis quatre mois, a le privilège de pratiquer les meilleurs jeux de la planète ? La spirale de la surenchère verbale que provoque cette production 2001 ne va-t-elle pas finir par nuire à nos propos ? Sans doute, mais que voulez-vous, après des dizaines de critiques amères les années précédentes, on ne va pas faire la fine bouche au moment où le paradis des jeux est à portée de main. Et puis, quand on rencontre des chef-d’œuvres il n’y a pas photo. Un critique de jeu vidéo n’est qu’un vecteur. Il doit faire passer l’information avec le plus de justesse et de précision possible, et la passion doit transiter par le raisonnable pour rallier les suffrages. C’est le standard que nous nous efforçons de maintenir, et même si les cotas de jeux extraordinaires sont en train d’exploser sur Overgame, et que l’incrédulité gagne même les rangs des professionnels, nous sommes bien obligés de témoigner du marché. Et l’information du jour c’est que ICO est un phénomène.
Mais d’où sort ce #@!?$* de bon jeu ?
Retenez bien ce nom : Fumito Ueda. Il est le Directeur et Game Designer de ICO. Entouré d’artistes forcément de haut niveau, dans une équipe apparemment nouvelle chez Sony Computer Japon, il semble être le responsable d’un jeu qui dépasse largement son statut de loisir pour rejoindre – lâchons le mot puisque le débat est ouvert sur Overgame * – celui d’œuvre-d’art. Il faut dorénavant surveiller les projets de cet homme car un jeu comme ICO ne survient pas simplement sur un carnet de commandes. Il faut bien un artiste avec une vision pour réussir un tel projet. Au cas où le doute s’infiltrerait affirmons dès cet instant que ICO est un véritable jeu vidéo. Aucun doute là-dessus. C’est bien le joueur qui est en contrôle, l’interactivité est à son maximum. Et si ICO réussit à faire vivre une aventure émotionnelle subtile et forte jusque là inédite dans les jeux vidéo, ce n’est pas ICO qui sort du cadre, c’est toute l’industrie qui est tirée vers le haut. Quand on parlera d’émotions dans un jeu vidéo, d’émotions subtiles qui ne s’appuient pas grossièrement sur la peur, le stress et l’hystérie, il faudra faire référence à ICO. Là où Silent Hill 2 rend adultes les sentiments de peur surexploités dans les jeux vidéo, ICO invente les rapports amoureux platoniques, où deux êtres apprennent à se découvrir en pleine adversité. L’angoisse existentielle de Silent Hill 2 est tournée vers l’intérieur, à l’autre bout du spectre émotionnel, l’interrogation existentielle d’ICO est tournée vers l’extérieur, vers l’autre personne, vers un décor vu du dehors, énorme et énigmatique. Pour trouver les réponses, l’un, introverti pousse son héros à se ronger de l’intérieur tandis que l’autre conduit vers l’extraversion à la conquête de son environnement. Silent Hill 2 creuse la nuit, ICO construit (édifie) le jour.
Parlons peu, parlons bien, parlons du jeu
Sur le jeu proprement dit il n’y a pas grand chose de plus à ajouter à notre avant-première. Non pas qu’ICO ne se laisse pas raconter, mais en l’absence de menu de gestion, de carte des lieux, de jauge de santé, d’accessoires, de magies, d’armement et de tout attribut habituel aux jeux vidéo, les explications sont forcément courtes. ICO est un petit bonhomme qu’il faut diriger à travers le labyrinthe d’une énorme forteresse médiévale. A sa disposition : un bâton pour se défendre, et une agilité reflétant son jeune âge et sa silhouette allongée. Emmuré vivant par les membres de son propre village parce que né avec des cornes, ICO s’arrache de justesse au tombeau où il doit mourir à petit feu pour croiser une autre victime de l’énorme prison. Le destin de sauveur devient inéluctable dès qu’on aperçoit la silhouette féminine gracile enfermée dans une cage suspendue plusieurs dizaines de mètres au-dessus du vide. Surtout que sans elle, pas de fuite possible. Les destins de la jeune princesse Yorda et de ICO sont dorénavant liés à la vie à la mort. Car pour s’arracher au tombeau de pierre il faudra l’agilité et l’esprit du garçon et la magie mystérieuse de la jeune fille pour ouvrir les portes… magiques. Plus simple et cliché est impossible, et pourtant, quel voyage !
La Forteresse de la solitude
Yorda et ICO sont les seuls êtres humains de cette aventure. Une troisième présence omniprésente hante pourtant le jeu : la forteresse qui les retient prisonnier. Ce château nordique et oublié par ses habitants est construit comme un véritable édifice. À une échelle gigantesque. Il y a le donjon où sont enfermés les nouveaux tourtereaux, la bâtisse principale et menaçante, corps central du monstre de pierre, les tours annexes, gardiennes symétriques qui permettront de déverrouiller les portes monumentales de l’enceinte, et des surprises… Quand les deux héros traversent les salles et autres jardins, cela n’a rien à voir avec une succession de niveaux artificiels mis bout à bout. Chaque salle, chapelle, tombeau, cour intérieure a une place justifiée dans l’architecture. On a vraiment l’impression de visiter une forteresse géante issue de l’habituel délire mégalomaniaque de l’homme. Pour dire : la conformité apparente de cette architecture rend les donjons de Zelda totalement artificiels en comparaison. Dépouillés et vides comme un château médiéval déserté, ce sont les différentes roches et architectures qui donneront une identité aux lieux. En sachant que l’échelle des salles continue dans le gigantisme. ICO et Yorda sont aussi petits dans le décor qu’un pèlerin au centre de la cathédrale de Chartres (par exemple). Crédible jusque dans ses arrières salles ou ses installations obscures, cette architecture grandiose n’a plus rien à voir avec l’habituelle conception de niveaux, prétexte à créer des embûches au joueur. Les deux héros reviendront d’ailleurs plusieurs fois sur leur pas (possible de faire complètement demi tour à n’importe quel moment en théorie) pour trouver leur chemin jusqu’à la sortie. L’impression d’écrasement et de menace est ainsi permanente. Et, quand à la véracité des lieux s’ajoute des éléments ésotériques énigmatiques, pas besoin d’un message en clair pour comprendre qu’il vaut mieux fuir.
« The incredible machinerie »
En cherchant la porte de sortie, ICO devra déclencher de curieux mécanismes. Rien de beaucoup plus étrange que ceux qui déclenchent un pont-levis ou une herse, et toujours logique avec le décor du moment (moulin à vent décrit, cascade d’eau intérieure, tombeau et, plus généralement, portes et pont-levis…). À une époque où poulies, poids et contre poids faisaient office d’énergie à la place de l’électricité, il est vite logique d’avoir à les déclencher. Même si le nombre de mécanismes plus ou moins directs est un peu plus élevé que la réalité ne le voudrait. L’important, et cela fait partie des grandes qualités de cette aventure, est que chaque élément est cohérent avec le suivant et qu’on y croit. Pour sortir de chaque espace il faut beaucoup observer les lieux (la caméra distante est contrôlable pour de magnifiques panoramiques et, en plus, le bouton R2 permet de zoomer à n’importe quel moment !), prendre des risques, essayer. La solution n’est jamais loin, jamais très compliquée, à condition de rester concentré.
Des cornes au naturel mais pas de magies artificielles
Nul besoin de super pouvoirs, à son âge ICO est souple et agile comme un gymnaste. Avec ce qu’il faut d’hésitation et de maladresse pour être humain (ICO trébuche, perd l’équilibre au bord du vide pour se rattraper in extremis), le petit personnage saute par dessus des précipices (la forteresse est construite à même la roche d’une falaise au bord de la mer), grimpe le long de chaînes (et s’y balance), se suspend aux corniches naturelles, nage. Son énergie est telle que la vitesse avec laquelle il tire ou pousse des caisses métalliques renvoie tous les autres habitués au royaume des escargots paraplégiques. Chaque geste et posture adoptée est d’une justesse effarante. Il faut remonter à Prince of Persia, Flashback et Heart of Darkness pour retrouver une telle précision dans l’animation. Il y a tellement de phases intermédiaires entre les gestes clés que ICO devient très vite une entité vivante. Il ne faut pas hésiter à zoomer sur lui dès que l’occasion d’une caméra rapprochée se profile, car ICO est aussi fignolé de près que de loin. Les ombres sur son corps réagissent en fonction de l’éclairage, du soleil, les mouvements de ses vêtements suivent la direction du vent, des mèches de cheveux frémissent, et ses yeux clignent naturellement. Tant de détails pour un personnage contrôlable la plupart du temps à distance est un des indices de l’amour du travail bien fait qui se dégage de ce soft.
Des personnages qui émeuvent pour de bon
La princesse Yorda est le premier personnage virtuel à exprimer tant de vie. Le joueur ne la contrôle jamais et, honnêtement, telle une vraie femme dans la vraie vie, le joueur masculin et le garçon ICO se demanderont tout le long de l’aventure ce qui la dirige, ce qui l’habite. Une fois libérée de sa cage, la lumineuse (elle cache un secret forcément) Yorda prend vie. Livrée à elle-même, elle se promène dans les salles. Hésitante, parfois capricieuse, elle rejoint quand même ICO quand celui-ci l’appelle. En insistant elle prend la main du garçon qui l’entraîne dans sa course. Et il faudra l’entraîner fermement d’une salle à l’autre pour survivre, quitte à être un peu brusque. Seulement comme elle n’a pas le même stamina que le jeune garçon, elle se fait un peu prier. Le contact entre les deux êtres est de ce point de vue, et de bien d’autres, remarquable. Yorda ne suit pas ICO dans sa course avec constance lorsqu’ils se tiennent par la main, du coup leur contact se relâche parfois, ICO est tiré malgré lui en arrière, ou bien elle est bousculée vers l’avant. Le lien grandissant qui les unie se tisse au fil des périls, au fur et à mesure que le joueur apprend à gérer le tempérament un peu lunaire de Yorda. Quand, après avoir franchit un précipice tout seul, ICO se retourne et tend la main vers la jeune fille pour qu’elle l’attrape en sautant dans le vide, le pouvoir émotionnel du jeu décolle littéralement.
Un seul bâton contre les ombres noires
L’essentiel du jeu demande jugeote et agilité, observation et adresse. ICO devra toutefois protéger Yorda en se battant avec son bâton (qui deviendra une épée bien plus tard). Les esprits esclaves de la forteresse n’ont qu’une idée : récupérer la princesse et la remettre dans sa cage. À intervalles irréguliers, des esprits, des ombres noires comme l’encre, surgissent de failles spatio temporelles dans le sol (de sombres portails magiques, si vous préférez). Changeant de forme sans arrêt, n’ayant pas vraiment de substances, ces esprits aux yeux fous (effets de bougés extraordinaires) tantôt araignées, tantôt goules, tantôt sortes de diables volant, chercheront inlassablement à arracher Yorda de la protection d’ICO. Des grands coups de bâton les réduiront à l’état de fumée noire, mais faut-il encore réussir à les toucher, car ils savent très bien esquiver. Les accrochages avec ces ombres sont aussi formidables que le reste du jeu. Et faciles, car il suffit d’être prudent et patient pour éloigner la menace. Il s’agit autant d’un jeu d’esquive que d’anticipation. Quand une goule réussit à mettre Yorda sur son épaule et à l’entraîner dans l’affreux trou noir du sol, in extremis, ICO peut toujours lui tendre la main pour l’arracher aux ténèbres ! Ça se complique quand les monstres, silencieux et animés comme une matière noire en mutation, se mettent à voler à travers une énorme pièce. Si jamais l’un deux arrive à kidnapper Yorda et à la transporter à l’autre bout de la salle gigantesque, il y a peu de chances que ICO ait le temps de la rattraper. Il faut donc soit empêcher totalement qu’une ombre lui mette la main dessus, soit positionner ICO près du trou où elle risque d’être absorbée. Un peu de tactique ne fait de mal à personne. Sinon c’est Game Over. Et on recommence la séquence à l’entrée de la dernière pièce (pas vraiment pénalisant). D’une manière générale il ne fait pas bon laisser Yorda seule trop longtemps, surtout pas dans une autre pièce. Sinon ICO entendra son petit cri, la longue note métallique caractéristique de l’apparition des esprits et il faudra la rejoindre au plus vite. Qui a dit que la vie à deux était facile ?
Une histoire qui survole les autres
Parmi les audaces du jeu, la façon indirecte et elliptique dont est racontée (non racontée) l’histoire est exemplaire. Les scénaristes se sont volontairement effacés derrière une forme abstraite de récit. Une façon qui convient parfaitement à un jeu vidéo puisqu’elle ne se juxtapose pas à l’interactivité. De la courte scène d’introduction utilisant le moteur 3D (pas de cinématiques ici, et c’est tant mieux), aux brèves « cut-scenes » éparpillées ici et là, ce sont surtout les longs et larges mouvements de caméra qui racontent. Quand ICO et sa compagne rentrent dans une nouvelle salle, la position de la caméra n’est jamais anodine. Presque à chaque fois, la vue d’ensemble hiérarchise (inconsciemment) les éléments architecturaux dans l’espace, soit pour justement donner un peu plus d’indices sur le grand « schéma » où sont plongés nos héros, soit pour commencer à donner une indication sur le problème qu’il va falloir résoudre. Alors que le jeu semble progresser tranquillement, chaque nouvelle vision architecturale, chaque sculpture nourrit le joueur tout en l’intriguant. Et la soif d’en savoir plus, de voir plus loin, devient inextinguible. À l’image de cette narration qui montre sans dire, Yorda parle parfois à ICO dans une langue étrange, inconnue. Les sous-titres affichés à l’écran révèlent une langue hiéroglyphique mystérieuse. Les sentiments passent dans le ton de la voix mais pas les faits. Un équilibre audacieux et, nous en sommes encore étonné, totalement réussi.
D’où vient le vent, hein ? D’où ?
Dedans, autour, par dessus et par dessous, l’autre entité qui habite l’aventure avec une force peu commune est le son. La musique éthérée est rare, elle laisse la place aux bruits d’ambiance qui n’ont jamais été mixés avec autant de réalisme. Les bises s’ajustent à la taille des pièces, à leur réverbération. Dehors, le vent souffle en fonction des endroits : quand les héros sont dans une cour à ciel ouvert ou sur la crête d’une falaise, l’air ne souffle pas de la même façon. Des oiseaux crient, et cela justifie les colombes et autres pigeons qui se posent ici et là et laissent des plumes s’envoler. Les mécanismes qui se déclenchent couinent de tous leurs métaux rouillés. L’eau paisible ou en cascade rend l’air humide et l’oreille confirme ce que l’œil perçoit. À ce titre, le bruissement des arbres accompagne les plus beaux feuillages (mobiles) qui nous aient été donnés de voir dans un jeu vidéo.
Le soin et le brio avec lequel le monde est recréé n’ont d’égal que dans sa capacité à rendre poétique l’ensemble. Ambiance écologique sans être bêtement new age, le pouvoir d’évocation du son rejoint l’image pour un spectacle émotionnel à couper le souffle.
Un soft optimisé pour l’éternité
Une fois le livre d’ICO refermé il reste dans le cœur et dans la bouche un double sentiment. Celui d’une aventure si prenante que l’on voudrait continuer encore et encore (10 heures en moyenne, soit tout de même, pour donner un ordre d’échelle : 2,5 fois des films fresques comme Ben-Hur ou Autant en Emporte le vent), et celui d’avoir terminé l’histoire comme il le fallait, comme l’histoire le réclamait, comme le voulait les auteurs. La sensation d’accomplissement au terme de l’aventure est presque sans équivalent. En puissance évocatrice elle dépasse même les satisfactions pourtant célébrées des jeux les plus lyriques, comme, encore et toujours, Zelda ou les Final Fantasy. À peine grandiloquent, totalement cohérent, fermant la boucle d’une histoire dont on ne connaîtra jamais les deux bouts, la conclusion d’ICO entraîne le jeu vidéo sur un rivage qu’il n’a jamais accosté.
Chef-d’œuvre inattendu, pour comprendre la finesse du propos de l’aventure, il suffit peut-être d’expliquer que, pour sauvegarder la partie, nos deux héros doivent trouver un banc de pierre, s’y asseoir ensemble et s’assoupir un instant avant de se réveiller, de renaître ensemble. Même à l’abri dans son canapé moelleux, le joueur ne pourra s’empêcher de partager le destin tragique et beau de ICO et Yorda. Sans doute la première idylle crédible du jeu vidéo.
François Bliss de la Boissière
(Publié sur Overgame le 24/10/2001)
Message aux lecteurs. Vous avez apprécié cet article, il vous a distrait un moment ou aidé dans vos recherches ? Merci de contribuer en € ou centimes de temps en temps : Paypal mais aussi en CB/Visa avec ce même bouton jaune sécurisé …
Comme dans la rue, pas de minimum requis. Ça fera plaisir, et si la révolution des microtransactions se confirme, l’auteur pourra peut-être continuer son travail d’information critique sans intermédiaire. Pour en savoir plus, n‘hésitez pas à lire ma Note d’intention.